Vers 2000 ans avant notre ère, les Shang, deuxième dynastie historique de Chine, originaire des plateaux d’Asie centrale, régnaient sur un peuple d’agriculteur dans la vallée du Fleuve Jaune.
Composés essentiellement de guerriers et de chasseurs, ils vénéraient, outre leurs ancêtres, des divinités naturelles telles que montagne, lac, brume, ravine, orage et tonnerre, feu et vent.
C’était une spiritualité chamanique basée sur la conviction que toute entité naturelle (humains, animaux, pluie, étoile) est animée par un esprit, « un Shen » et que toute action entreprise devait recevoir le consentement des invisibles.
Pour ce faire, comme dans la majorité des peuples primordiaux, on sacrifiait à tour de bras des animaux en les brûlant. Mais, pragmatiques, les sages s’interrogèrent: comment savoir si les esprits étaient contents ?
En observant les apparitions de striures sur les os, à la fin du rituel, les Shang vont émettre une hypothèse surprenante : et si le feu sacrificiel n’était pas seulement l’agent qui modifie la nature terrestre des offrandes en les envoyant au ciel, pour les transformer en aliments spirituels, comestibles pour les esprits, mais qu’en plus le rituel induisait un mouvement de rétroaction du monde de l’invisible à celui des humains par le biais de ces craquelures ?
La pratique leur a enseigné que, si tous les sacrifices ne sont pas également « rentable », en revanche, tous laissent des traces sur les os. Donc les esprits signifient de toute façon leurs réponses. Pourquoi ce sacrifice-ci est rentable, pourquoi celui-la ne l’est pas ?
Ils ont remarqué en outre que les craquelures changent selon les saisons, l’atmosphère.
Les Shang vont en déduire tout naturellement que ce qui régit la réponse n’est donc pas due à l’humeur des dieux ou à la qualité de l’offrande, mais au moment du sacrifice…
Et donc, guidés par cette intuition, ils vont muter lentement vers le choix du temps comme axe de référence et vers la qualité du moment comme unité de mesure.
En analysant les réponses a posteriori, ils vont comprendre que le sacrifice a été fait au moment adéquat ou à contretemps et en déduire que l’efficacité du sacrifice existe conséquemment antérieurement à sa réalisation.
Un nouveau cérémonial va donc se mettre en place : peu à peu, les craquelures vont cesser d’être vues comme les marques d’une volonté supérieures pour devenir simplement les indices visibles de la qualité du moment. Ce tournant va modifier les rapports que les anciens Chinois entretenaient avec leurs dieux vers une conception « énergétique » et laïque de leur spiritualité.
Premier conséquence pragmatique à la chinoise : pourquoi faire un sacrifice si la divination préalable indique que ce n’est pas le bon moment ? Pourquoi aussi faire un sacrifice si la réponse est positive ?
En déplaçant le problème de l’opportunité du sacrifice – implorer comme il faut – vers l’opportunité de l’entreprise – agir au bon moment -, ils vont se soustraire à l’arbitraire religieux pour entrer dans un univers qui fonctionne de façon raisonnable, en un réseau de concordance énergétique.
Ils vont ensuite raffiner la pratique en bricolant la théorie.
Plutôt que d’approcher les os du brasier, on va amener le feu sur l’os en tirant du foyer un brandon.
Plus important, en s’autorisant à agir sur le mode de production des signes venus du ciel, les officiants prennent une part active au processus qui les fait apparaître. Ils se posent ainsi en coauteur des signes produits dont ils savent discipliner l’apparition.
Cette mutation va se cristalliser définitivement avec l’apparition de la divination sur carapace de tortue. Pour les Chinois, la tortue est à l’image de l’univers, un modèle réduit du cosmos, avec ces deux carapaces, celle du dessus ronde et unie comme le ciel, et celle du dessous plutôt carrée et divisée en secteurs comme la terre. Utiliser la tortue c’est interroger l’univers lui-même.
Comment s’y prend-on ?
La carapace dorsale symbolisant le ciel, on utilise la carapace ventrale dont on a soigneusement raclé les chairs jusqu’à ce qu’il ne reste plus que l’écaille elle-même. Puis on la polit pour éliminer toute trace d’humidité qui, à la chaleur, altérerait les signes divinatoires et leurs interprétations.
Avec la tortue, le principal souci des officiants est d’accroître la lisibilité du résultat en réduisant et en disciplinant les multiples fissures que provoque sur la pièce l’approche de la source de chaleur – un brandon incandescent.
Plus besoins de sacrifice, pour les officiants qui se servent des tortues, on approche le tison d’un certain nombre de point dans la carapace interne et un certain nombre de craquement apparaissent sur la face externe.
Pour la première fois dans l’humanité, le hasard a été apprivoisé.
Le résultat est que les fissurations, précédemment manifestations des puissances surnaturelles, sont maintenant propriété du pragmatisme chinois qui n’hésite pas à les configurer à sa guise dans un seul souci d’efficacité.
Les Chinois sont des archivistes impénitents. A la suite de l’auguration préalable, les pièces oraculaires ne sont pas détruites mais soigneusement conservées et entreposées et finissent par constituer une énorme banque de données.
D’autant que les officiants vont prendre l’habitude de graver à côté des fissures des signes résumant comment le tirage a été fait, les conclusions qui en ont été tiré.
En examinant ces carapaces, la première chose qui retient l’attention est l’organisation globalement symétrique des différents éléments.
De part et d’autre de l’axe central se répondent deux colonnes de signes et de fissurations. Cette disposition n’est pas fortuite, la symétrie est préalable dans la direction dans laquelle on a orienté les fissures, la dissymétrie survient ensuite, résultat de la manière dont s’accomplit l’aléatoire du moment. Et de fait sur les tortues chaque brûlage est numéroté. Les fissures sont superposées. La démocratisation du processus auprès de toutes les familles chinoises de haut rang, va bientôt avoir un résultat écologique étonnant. La disparition des tortues d’eau douce en Chine septentrionale.
Fu Xi, l’inventeur génial des hexagramme ne fera en fait que recopier et interpréter en traits pleins et brisés les striures de tortue.
inspiré du « Discours de la tortue » par Cyrille J-D Javary



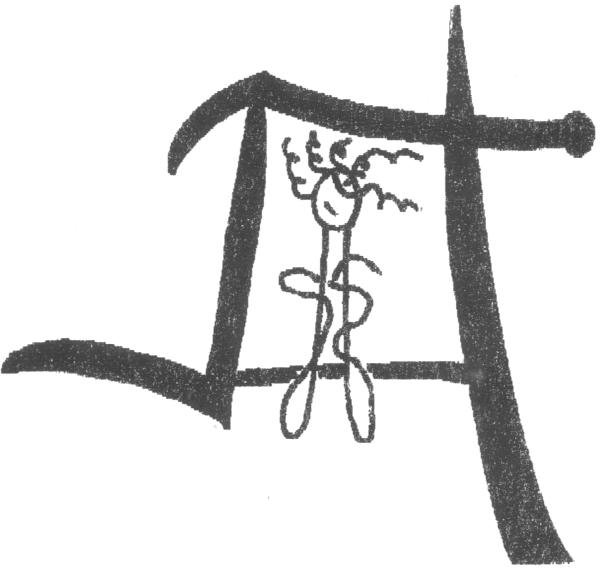
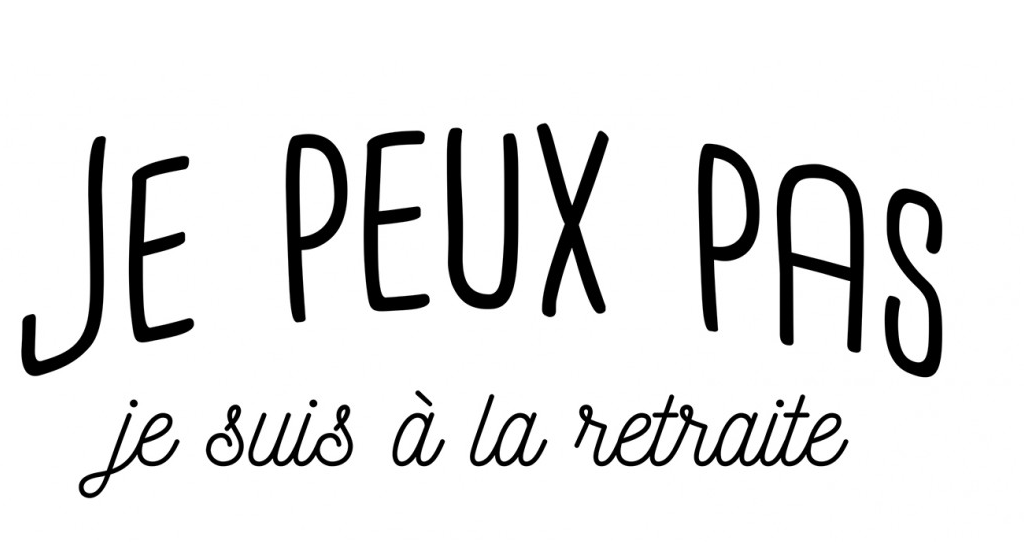

.JPG)